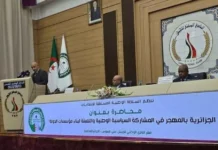Leur chef de file était le légendaire capitaine Dibi Silas Diarra. Arrêtés, ils furent inculpés de complot contre la sûreté de l’Etat, traduit du 10 au 14 décembre devant la Cour de sécurité de l’Etat et condamnés à des peines allant de cinq ans aux travaux forcés à perpétuité. Certains de leurs juges sont aujourd’hui sur le banc des accusés du procès «Crimes de sang» : les généraux Amara Danfaga et Mamadou Coulibaly. D’autres sont retraités ou décédés. Deux jours après le verdict, neuf des condamnés considérés comme les cerveaux du complot furent transférés à Tombouctou, puis à Taoudénit, où ils arrivèrent le jour de Noël de l’an 1969.
Taoudénit, une mine de sel à 900 km au nord de Tombouctou où le gouvernement militaire érigea quelques mois plutôt «un centre de rééducation».
Au départ des condamnés de Bamako, le lieutenant Tiécoro Bagayogo leur lança un « Au revoir Messieurs les touristes !». De ces neuf « touristes » seuls, trois reviendront. L’un d’eux succombera des séquelles de sa détention. Le Sergent chef Samba Sangaré est un des deux survivants.
Lisez ci-dessous le récit cauchemardesque d’un revenant qui en a vu. Il parle de la mort de ses camarades, des travaux forcés, de la brutale sauvagerie de leurs geôliers, de la torture, de la maladie, de la sous alimentation. Il relate comment Moussa Traoré a envoyé mourir à Taoudénit certains de ses compagnons de la première heure, l’arrivée de patriotes comme Victor Sy.
Lisez comment sur cette terre de vieilles civilisations, l’homme déshumanisa l’homme.
Un témoignage hallucinant et accablant au moment où se tient le procès «crimes de sang», Une page sordide des crimes commis sous le règne du Général Moussa Traoré.
Le Républicain: Ainsi, vous avez passé dix ans dans l’enfer de Taoudénit
S.S. : Nous sommes arrivés à Taoudénit le 25 décembre, à Noël. Il fait froid au nord, mais à Taoudénit. Il fait plus froid que partout ailleurs au Mali. Le lieutenant Almamy Nientao, chef de poste militaire, nous a empêché de porter les tenues civiles que nous avions c’est à dire les pull-overs, les manteaux ou les pantalons pour nous protéger contre le froid. Il a exigé que nous, les anciens militaires, porterions uniquement la tenue pénale qui était faite de la chemisette avec des bretelles sur les côtés et le short. C’est comme ça pendant le mois de décembre à Taoudénit que Nientao nous a fait travailler. On ne pouvait même pas porter un maillot de peau.
Le Républicain : Quelles étaient vos conditions de détention ?
S.S. : Lorsque nous sommes arrivés, Nientao nous a dit que la note qui nous accompagnait précisait que les militaires ne doivent pas nous considérer comme d’anciens compagnons d’armes mais comme étant des gens entrés en opposition. Donc pas de pitié.
Dans ces conditions là, notre détention a commencé de façon extrêmement draconienne. La nourriture à l’époque était extrêmement défectueuse. C’était le mil rouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1969, il y avait le mil rouge dans le pays, et c’était ce mil rouge qu’on nous avait envoyé, qu’on mangeait sans viande, ni poisson, concassé rapidement et cuit à l’eau salée.
Le Républicain: Vous aviez combien de repas par jour? Trois?
S.S.: Trois, c’est trop dire. On avait tout juste deux repas à midi et la nuit, toujours c’était le même mil rouge sans viande, sans poisson, cuit à l’eau.
Le Républicain: Ce régime a duré combien de temps?
S.S. : Pendant très longtemps. Pour tricher un peu, nous troquions nos habits civils contre de la nourriture que nous faisaient parvenir certains détenus de droit commun qui avaient l’avantage de travailler chez les militaires. Ils allaient faire des corvées là-bas et les militaires, après les repas, leur donnaient le reste et eux-mêmes ils nous amenaient ces restes pour les vendre. Donc, vous donniez votre grand boubou contre 12 ou 15 boîtes et chaque jour, le prisonnier s’engageait à vous apporter une boîte du reste de riz des militaires.
Donc, c’est comme ça qu’on trouvait à manger pour améliorer notre ordinaire. Lorsque le boubou est fini, vous engagez le pantalon et ainsi de suite. Mais le jour où Nientao a été mis au courant, il a mis fin à cela. Désormais, c’est lui même qui suivait les repas des soldats et quand ils avaient fini de manger, il creusait le sable et y mettait le reste pour que ça ne nous parvienne pas. Il disait que sans cela, nous ne mourions pas, alors que nous avons été envoyés pour mourir et lui il tient à avoir l’honneur de nous avoir tués.
Le Républicain: Votre lieu de détention était-il loin du poste militaire?
S.S. : La prison et le poste militaire étaient tous ensemble. Il y avait juste un mur qui nous séparait. Il y avait le quartier des détenus et le quartier des militaires.
Le Républicain : Et là vous aviez des cellules?
S.S. : Pour ce qui nous concerne quand on arrivait, il n’y avait pas encore de cellules pour nous accueillir. On nous a entassés dans une petite chambre où on était obligé de dormir à tour de rôle parce que tous les neuf on ne pouvait pas dormir côte à côte. Parce qu’il fallait qu’au moins trois soient assis pour que les six autres puissent se coucher. Après on réveillait trois. Donc on faisait comme ça pendant trois ou quatre jours, le temps qu’on ait construit la baraque dans laquelle nous avons effectivement aménagés. C’est nous qui l’avons construite. C’était une pièce exiguë faite sur mesure, longue mais quand vous vous couchiez vos pieds touchent un mur, votre tête l’autre.
Le Républicain: Qu’aviez-vous comme literie dans votre première case de détention ?
S.S. : Des nattes qui souvent manquaient. Des couvertures «Kaasa»
Le Républicain : Quel était le régime ? On vous enfermait à quelle heure?
S.S. : On nous enfermait tous les soirs à partir de 18 heures et on nous menottait deux à deux. C’est très incommode. Quand l’un a besoin d’aller aux toilettes, il réveille l’autre, ainsi de suite.
Nous étions menottés deux deux : enfermés avec une sentinelle à la porte. Tous les jours, que Dieu fait.
Le Républicain: Et on vous ouvrait à quelle heure ‘!
S.S. : Dès fois pour le besoin, quand il fallait partir travailler dans la mine de sel. Le travail plus pénible à Taoudénit, c’est le travail de la mine de sel. Comme la mine de sel se trouve à 15 km, on nous réveillait à 4 heures du matin, toujours enchainés à deux avec des militaires qui nous encadrent avec des fusils, certains avec des cravaches pour accélérer la marche. On nous envoie à la mine de sel. Et là nous travaillons toute la journée jusqu’au soir, vers 17 heures. On prend le chemin du retour, toujours à pied, escortés de militaires en armes, ou en cravaches pour que nous accélérions. Après nous avoir battus toute la journée, dans les trous de la mine.
Le Républicain: Dans la mine de sel, on vous servait un repas à midi ?
S.S.: Oui on nous servait toujours un repas à midi à base du mil rouge.
Le Républicain : Les prisonniers étaient-ils seuls dans la mine?
S.S. : Non! Il y avait les travailleurs qui étaient des hommes libres. Eux ils étaient là. Ce sont eux qui nous ont appris comment travailler dans la mine! Et à partir de cet instant là, on n’avait rien à voir avec eux.
Le Républicain: Pendant dix ans, vous avez travaillé tous les jours dans la mine de sel ?
S.S. : A la mine de sel. Parfois dans le camp même, au niveau du pénitencier, avec la corvée de ramassage de crotte de chameau. C’est avec ça qu’on préparait le repas. Le besoin s’en faisait sentir.
Il fut un moment où nous avons construit un Fort qui porte le nom de Nientao, parce que c’est lui qui a tenu à ce que le Fort soit construit. C’est lui qui en a tracé le plan et qui a commencé à le construire avec nous, comme maçons et manœuvres. Ce Fort existe encore là bas. Il porte le nom de Fort Nientao. Donc, lorsqu’on n’était pas à la mine, on était en train de travailler le banco. Pour ce qui concerne le travail de banco, je vous dirai que quand nous étions nouvellement arrivés, Nientao nous a demandé de faire 100 briques par jour à notre groupe. Vous comprenez bien pour les gens qui n’étaient pas habitués à faire des briques, faire 1000 briques à partir du banco qu’ils doivent creuser eux-mêmes, tirer l’eau du puits, remplir plusieurs dizaines de fûts, les pousser dans le sable jusqu’à pied d’œuvre, pétrir le banco, faire des briques, c’était trop nous demander. Nientao disait que ça ne le regardait pas.
Il citait un proverbe bambara: « quand on dit qu’un pilon ne peut pas être enfoncé dans l’anus d’un poulet c’est qu’il est dans les mains de quelqu’un qui lui veut du bien».
Il voulait 1000 briques de 7 heures à 16 heures. Si à 16 heures nous n’avions pas fini, il nous envoyait des militaires pour nous cravacher. Pendant près de 10 jours, tous les jours si on ne réussissait pas à faire les 1 000 briques, les soldats nous cravachaient à 16 heures.
Finalement nous avons fini par réussir à le faire au prix de mille efforts. Donc les 1000 briques, réalisées et séchées, il fallait construire. Là on lui avait dit que nous ne sommes pas maçons. Il a dit qu’il ne veut rien savoir, il faut construire ce Fort. Nous avons commencé à travailler en qualité de maçon cette fois. Nous avons tracé le Fort 100 mètres sur 100. In Fort énorme avec beaucoup de cachots, de labyrinthes, de trucs impensables. Donc en construisant ce pont, il venait nous montrer la longueur et la hauteur à atteindre, si on ne l’atteignait pas, les soldats venaient nous battre. On faisait tout, on travaillait fébrilement sous les cravaches des soldats. Quand il venait et regardait et que c’était tordu, il disait que c’était du sabotage. Il nous faisait battre pour sabotage. Lorsque le mur s’effondrait, là aussi c’est du sabotage,
Donc il a créé toutes les conditions pour nous faire battre. La première fois que nous avons eu un blessé, c’était le capitaine Alassane Diarra. Un soldat l’avait frappé avec son ceinturon et blessé au front. Le sang a jailli et le soldat a eu peur. Il a dit : «chef il y a un tel qui est blessé et Nientao a répondu: ce n’est rien, quelqu’un qui est venu pour mourir, s’il est blessé, ce n’est rien. Continue. Une autre fois on avait frappé l’un d’entre nous sur le sexe et quand on l’a signalé à Nientao « on a frappé un tel sur le sexe », un caporal a dit : « non ne frappez pas sur le sexe », Nientao a répondu : « non il n’en aura pas besoin de toute façon ». Donc on a travaillé dans ces conditions là, et le rythme du Fort se fait au pas de gymnastique: quand vous allez chercher le banco, vous courez, quand vous revenez, vous courez, Donc toute la journée vous courez avec le banco et même si vous demandez la permission d’aller aux toilettes, vous devez courir. C’est dans une atmosphère infernale qu’on a construit ce Fort.
Le Républicain: Vous êtes partis neuf, combien ont survécu?
S.S, Trois sont revenus sur les neuf.
Les six autres sont morts à Taoudénit et de mort extrêmement pénible parce que c’est Nientao qui est à la base de tout ce qui est arrivé à Taoudénit. Il a dit qu’en ce qui nous concerne, nous ne devons être considérés comme étant malades que lorsque nous avons atteint le seuil de l’hospitalisation. C’est en ce moment que nous devons commencer à considérer que nous sommes malades, Tous les camarades sont morts sur le chantier. Personne n’est mort dans son lit parmi nous, si on peut parler de lit là-bas. Diby, Bakary, Boubacar, Mamy tous sont morts au chantier.
Pour lui, même si quelqu’un d’entre nous était malade au point de ne pas pouvoir travailler, on le transportait à bras le corps, on l’exposait au soleil, aux intempéries sur le chantier. Les malades qui ne pouvaient pas travailler étaient transportés, on venait les mettre là ou les autres travaillaient. Si c’était le soleil, ils étaient au soleil. Si c’était le froid, ils étaient au froid, si c’était le vent, le vent.
Le Républicain : Quels sont les trois qui sont revenus?
S.S. : Il y a moi-même Kédiouma Samaké, un adjudant. Alassane Diarra est revenu mais malheureusement il n’a pas survécu longtemps puisqu’il est revenu complètement ruiné. Il est mort des séquelles de la détention.
Le Républicain: Pouvez-vous me parler des circonstances de la mort de vos compagnons?
S.S. : Les circonstances, c’est pas compliqué. C’est le mauvais traitement, les exactions, les sévices corporels, la malnutrition, le manque de soins. C’est tout ça combiné savamment qui a fait que nos camarades sont morts de béribéri. C’était la maladie générale à Taoudénit, il n’y avait pas de vitamine. Je vous ai dit qu’on mangeait le mil rouge. Quand on mange le mil rouge, c’est évident qu’il n’y a pas de vitamines dans le corps. Le béri-beri, c’est une maladie qui enfle le ventre, les membres et même les bourses.
Le Républicain: Il n’y avait pas d’infirmier là-bas ?
S.s : .Il y avait un infirmier militaire qui accompagnait toujours le détachement qui est présent là-bas. Mais pour ce qui nous concerne, les soins, je vais vous dire comment ça se passait.
D’ abord on nous empêchait d’aller à l’infirmerie parce que Nientao disait que cela faisait perdre du temps. Donc l’infirmier transporte son plateau au chantier, il vient avec une ou deux seringues chargées de je ne sais quoi et il demande aux malades de dire ce qui ‘ils ont. Chacun dit ce qu’il a : «j’ai mal à la tête, aux yeux, au ventre. etc … » Quand il finit d’écouter tout le monde, il prend une seringue et il en administre à chacun un peu de ce liquide là, quelle que soit la maladie. Uniformément le même soin. Je me souviens il y avait quelqu’un qui avait une plaie au pied. Ils nous ont trouvé en train de pétrir du banco et vous sortez du banco, vous nettoyez votre plaie et vous montrez à l’infirmier qui met son badigeon et aussitôt vous rentrez, vous continuez à pétrir le banco et le soin était fait.
Le Républicain : Revenons à vos compagnons disparus. Comment et quand le capitaine Diby Silas Diarra est mort?
S.S. : Diby, il faut dire qu’on s’acharnait énormément contre lui. Nientao disait qu’il fallait qu’il paye le tribut de la célébrité, ce sont ses termes. Donc, chaque fois qu’on nous battait, la consigne était de s’acharner plus sur Diby. Tous ces sévices corporels, plus le manque de nourriture, le surcroît de travail ont fini par avoir raison de la santé de chacun de nous à un moment ou à un autre. Même malade – je vous ai dit qu’on ne nous considérait pas comme malades – Diby, on continuait à l’envoyer au chantier. Le jour où il mourut il était en train de pousser un fût et vite pour l’emmener au puits. Il y a un soldat Tamacheck qu’on avait désigné pour le battre parce que soi-disant qu’il avait sévi contre leurs parents. Ce soldat vit encore. Il est à la retraite à Bouressa. Il s’appelle El-Meidy. C’est ce soldat qui le frappait pour pousser le fût vers le puits. Il était si faible et malade que finalement il est tombé sur le fût et puis il n’a plus bougé.
On nous a appelés à côté. Nous étions dans un chantier. Je suis venu avec un ou deux camarades. Nous aussi, nous étions si faibles que nous ne pouvions pas le soulever. Finalement on l’a trainé jusqu’à la chambre. C’est ainsi qu’il a rendu l’âme ce jour-là. Mais après avoir subi mille et une souffrances.
Le Républicain : Quand est ce qu’il est mort ?
S.S. : Le 22 juin 1972.
Le Républicain : En 1972, a-t-il été le premier à rendre l’âme ?
S.S.: Non le premier est le capitaine Tiécoura Sogodogo, mort le 16 février 1972. Après le capitaine Sogodogo, c’est le lieutenant Jean Bolon Samaké qui rendit l’âme le 27 mars 1972. Ensuite ce fut le tour du capitaine Bakary Camara, le 1er mai 1972.
Après Diby c’est le tour du sergent chef Boubacar Traoré. Le jour où Boubacar mourut, il était si malade, si faible que son corps ne pouvait plus supporter sa tête. Le sergent-chef qui était chef de poste à cette période a demandé qu’on le sorte pour qu’’il aille travailler. Ce sergent chef s’appelle Nouha. Ils sont allés le chercher. On l’a fait sortir, on l’a mis au lieu de rassemblement. Ce Nouha a demandé qu’on le fouette car il ne serait qu’un paresseux et le soldat qui a été désigné pour le battre a dit: «vraiment chef, je ne peux pas le battre». On l’a rentré ce jour là et il est mort le 7 juillet 1972. Et jusqu’à sa mort, on pensait qu’il pouvait travailler. Après Boubacar, c’est le lieutenant Mamy Ouattara qui mourut le 31 juillet 1976.
Le Républicain: Vous parliez tout à l’heure d’un sergent-chef qui était chef de poste, est-ce à dire que le lieu· tenant Nientao avait quitté Taoudenit ‘!
S.S. : Oui ! Après un premier séjour de quatre mois, il est parti à Tombouctou, puis revenu à Taoudenit comme chef de centre.
Mais avant de quitter la toute première fois, après nous avoir fait subir les misères que vous savez, il a laissé des consignes strictes pour nous faire souffrir. Quand le détachement de relève est arrivé; il a mis une haie de soldats avec cravaches, chaque détenu passe dans cette haie. C’est pour montrer aux nouveaux arrivés comment il faut traiter les prisonniers politiques comme de droit commun.
En plus, en ce qui nous concerne, nous les anciens militaires, il nous a couchés à plat ventre côte à côte et il nous a marchés dessus, un aller et retour avec des godasses. Il a passé la consigne qu’il ne fallait, en aucune manière, avoir pitié de nous et qu’il fallait nous écraser le plus vite possible. Même ceux qui n’étaient pas disposés à nous faire du mal le faisaient par peur. C’est pour cela que je dis que c’est Nientao qui est à la base de tout le mal que nous avons eu à Taoudénit.
Il a dit aux soldats : «ces gens sont venus pour mourir, aucun d’eux ne retournera à Bamako. Donc ne craignez pas les représailles. Celui qui m’aidera à les tuer, s’il est soldat j’en ferais un caporal, s’il est caporal j’en ferais un sergent». C’est comme ça qu’il les a conditionnés contre nous. Et le même Nientao nous obligeait à le saluer comme on saluait le Moro Naba, en rampant et en disant « baba, baba » (père, père). On a fait 6 mois comme ça. Et après on mettait nos fronts contre la terre pour saluer Nientao, c’est ce qu’il demandait Et on est resté des années à faire ça.
Il a fallu l’arrivée à Taoudenit de Django Sissoko, alors directeur des prisons, pour mettre fin à cette pratique humiliante.
Le Républicain: Receviez-vous des lettres et des colis de vos parents ?
S.s. : C’est à partir de la deuxième année qu’on a accepté qu’on reçoive des colis de médicaments et une somme de 5 000 F par trimestre.
Le Républicain: Receviez-vous des lettres ?
S.S. Oui, deux deux fois par an.
Le Républicain : Pouviez-vous envoyer des lettres ?
S.s. : Oui ça passait toujours par les services de sécurité. La lettre n’était pas fermée.
Le Républicain: Vous ne pouviez pas donner d’information sur vos conditions de détention?
S.s. : Non, non, pas du tout Un moment donné, Nientao nous a dit: « Bon j’ai étudié, analysé les raisons qui font qu’à présent, personne de vous n’est mort. Parce que vous recevez 5000 F par trimestre ». A partir de ce moment il a écrit à Tiécoro pour lui demander d’arrêter l’envoi des mandats. Tiécoro a répondu favorablement. .
On nous a obligé à écrire et à dire à nos parents de ne plus nous envoyer l’argent parce que on n’en a pas besoin. C’est pendant la période qu’on ne recevait pas d’argent, qu’on a commencé à enregistrer des morts dans nos rangs.
Quand les intellectuels venaient, pour les décourager, pour les intimider on montrait les malades qui étaient sur place. Vous avez le cas de Alassane Diarra qui était vraiment malade, très malade. On a dit: vous avez vu ça. C’était un capitaine, voilà ce qu’on en a fait ». Donc à bon entendeur salut. Après on leur a fait voir le cimetière des prisonniers. Je dis là également que Nientao a dit que prisonniers nous ne devons pas être mêlés aux hommes libres même morts. Dons il a fait un cimetière de prisonniers à part. Donc on leur a fait visiter ce cimetière de prisonniers. On leur a fait visiter le Fort Nientao qui était en construction voir comment on cravache les gens qui le construisaient. Ensuite on les a amenés à la mine, voir comment on les maltraitait, combien ce travail était difficile. Après tout ça, on les faisait repartir en leur disant: à bon entendeur salut.
Le Républicain : Aviez-vous de quoi lire ?
SS. : Non, on ne lisait pas, on n’a pas de lumière, On nous avait totalement interdit de lire. Une fois, une mission sanitaire est passée à Taoudénit. Il y avait le docteur de l’armée, Sall, le docteur civil Mahamane Maïga je crois et puis d’autres infirmiers et un lieutenant Michel Sangaré. Alors quand ces gens sont arrivés, ils nous on demandé nos problèmes. On leur a dit surtout on voulait avoir de la lecture. S’ils pouvaient faire en sorte que nous ayons des livres, des journaux ça serait une bonne chose. Je crois qu’ils ont discuté après avec Nientao.
Nientao était fâché qu’on ait parlé de lecture, disant que nous ne travaillons pas assez et que nous pensions à lire. Devant cette mission sanitaire Nientao nous a cravachés, nous a fait sortir, a fait courir, faire des corvées devant ces gens-là. Une manière de nous dire que ces gens ne peuvent rien pour nous.
Le Républicain : Cette mission sanitaire a dû faire un rapport ?
SS.: Bon pas tout sûrement. Il y avait le sous-lieutenant Michel Sangaré qui était intéressé réellement par la chose. Il s’intéressait à notre nourriture. Après la commission, il est retourné, il s’est renseigné, il est allé à la cuisine, il a vu comment on prépare. Il a vu ce qu’on mangeait. Après, il parait qu’il a fait un compte rendu objectif; c’est le seul qui a paru vraiment s’intéresser à notre sort réellement. Tous les autres fermaient yeux. Sall notamment ne s’est pas du tout intéressé à notre situation.
Le Républicain: Vous avez p 10 ans au bagne de Taoudénit, vous avez été libéré à l’expiration de votre peine. Vous avez dû voir d’autres opposants réels ou supposés du régime de Moussa Traoré,
SS. : Nous en avions vu bien qu’on ne nous permît pas de prendre contact avec eux. C’est le cas de Ibrahima Ly, de Victor Sy et d’autres intellectuels. On m’a dit qu’il y avait un certain Cyr Mathieu Samaké que je n’ai pas connu moi même. Il y avait un groupe de commerçants qui s’étaient trouvés sur le chemin de Tiécoro. Les commerçants sont passés, disait-on, pour une histoire de farine et Tiécoro les a envoyés à Taoudénit pour 3 ou 4 jours et ces commerçants, je dis qu’on les a rasés, on leur a laissé des touffes ridicules sur la tête, On leur a fait pousser des fûts d’eau, on les a battus et ensuite ils ont quitté le bagne.
Le Républicain: Vous avez parlé de Victor Sy. Pouvez-vous relater son arrivée?
S8.: Victor Sy, on l’a vu un matin à notre réveil. On a su que c’est lui qui était là et un caporal qui était là-bas a été désigné pour aller «l’accueillir, comme on disait. Avec des cravaches, il constitua le comite d’accueil et ils allaient cravacher Victor Sy mais quand on a enlevé sa chemise on a vu que son dos était complètement labouré. Il avait été déjà cravaché ailleurs. Alors le caporal a dit : « celui-là, il n’y a pas un endroit où on peut le taper. Alors Victor Sy n’a donc pas subi l’accueil.
Le Républicain : Fe façon générale, ces détenus, étaient-ils gardés dans la même enceinte que vous?
SS. : Oui parce qu’à leur arrivée on éloignait certains détenus de droit commun pour leur faire de la place. Généralement, ils restaient trois jours, une semaine au maximum. On ne permettait pas du tout qu’ils nous rapprochent. Généralement c’est par renseignement, comme ça, qu’on savait que c’était X ou Y qui avait passé.
Le Républicain : Avez-vous été témoin de l’arrivée du capitaine Yoro Diakité ?
S.S.: Yoro Diakité, Siméon Sidibé, un sergent-chef et Malik Diallo sont venus à trois. On leur a fait partager la même chambre que nous. Déjà, il y avait beaucoup de morts dans nos rangs. Donc il y avait de la place. Yoro est resté 6 mois, 8 mois au maximum, après il est mort de la même manière que les autres. D’épuisement, de maladie, de sévices corporels. Il a été beaucoup bastonné.
Le Républicain: On le faisait travailler aussi ?
SS : Comme tout le monde! Et bastonné comme tout le monde ! Lui notamment! Sur le chemin de la mine, Yoro n’était pas un grand marcheur, on l’obligeait à aller vite. Il était parmi les derniers qu’on fouettait toujours. Il avait constamment les jarrets enflés, des plaies partout.
Le jour où il est mort, plutôt le jour où on l’a tué, il était en train de transporter du banco. Il est venu nous dire à nous qui étions maçons qu’il est malade. On est allé voir le caporal Diolo Dao qui doit être à la retraite à Goundam. Il a dit : « caporal, je suis malade ». Le caporal a dit: « allez c’est un paresseux. Puis il a appelé les cravacheurs. Deux soldats sont venus, on l’a cravaché. Il a repris son plateau, il est parti autour du sel. Il a fait deux ou trois voyages. Il a dit vraiment, ça ne va pas, il est allé revoir le même caporal pour lui dire qu’il est malade. Le caporal a appelé de nouveau les cravacheurs qui sont venus le cravacher. Là, il ne s’est plus relevé. On l’a laissé là sur le sable. De temps en temps, un soldat venait le soulever avec ses rangers pour voir s’il est toujours vivant. Il disait: » chef il n’est pas mort encore, le petit peulh est dur hein ! » Le chef qui était sur le mirador et regardait tout ça disait: « on a vacation avec Tombouctou d’ici une heure, pourvu qu’il meurt d’ici là. Ainsi, je pourrais l’annoncer à Tombouctou ».
Finalement, il était presque 18 heures. C’était la fin de la corvée. Nous, on nous a amenés dans notre cellule. On nous a enfermés. Et Yoro on l’a pris, on l’a mis dans une cabane désaffectée mais pleine de sable. Le matin on l’a retrouvé recouvert de sable, sans toit, ni rien. Il était mort. On l’a secoué, on l’a sorti, on l’a lavé et enterré. Voilà comment est mort le premier chef du gouvernement du CMLN de Moussa Traoré, le 13 juin 1973. Il est mort en train de transporter du banco pour construire une cuisine. Il n’a pas fait un an.
Le Républicain: Le groupe de militaires qui avait tenté un coup d’Etat en 1977 vous-a-t-il trouvé à Taoudenit ?
S.S. : Oui. Il s’agit du groupe des adjudants Mamadou Lamine, le fils de Fily Dabo Sissoko et de Balla Konaré. Ils sont arrivés à Taoudenit affaiblis par une longue détention. Comme tous les autres, ils ont été victimes de travaux forcés dans la mine, de sévices, de sous alimentation et de maladie. Mamadou Lamine Sissoko est mort après ma libération. J’en ignore la date. Il avait une santé fragile et on ne le ménageait pas, Six autres membres de son groupe ont péri à Taoudenit.
Le Républicain :. Tiécoro Bagayogo qui au moment de votre départ vous a dit au revoir les touristes, vous a trouvé à Taoudenit. Pouvez-vous nous parler de son arrivée et de celle de Kissima Doukara ?
S.S. : Ils sont arrivés un après-midi. On les a sortis devant le camp militaire. Après avoir fait l’appel des prisonniers, les militaires les ont conduits à nous dans le carré des prisonniers et on leur a dit d’aller s’adresser à Vieux Samba (c’était moi) moi) pour loger les uns et les autres. Sur place ils étaient tous gênés. Kissima, Tiécoro etc … Tous ces gens qui nous connaissaient. Il n’y avait que les policiers qui ne nous connaissaient pas et que nous ne connaissions pas. Nous avons mis beaucoup de temps, d’efforts pour les mettre à l’aise, pour que la glace soit rompue entre nous. Nous avons mis un trait sur le passé. Ils avaient leur problème.
Nous, on ne voulait rien rajouter. On les laissait avec leur problème. Nous n’avons pas exercé de représailles sur eux, ni de paroles amères.
Ils n’ont pas été accueillis de la même manière qu’on a voulu accueillir Victor Sy. Non. Parce que premièrement ils n’avaient pas été jugés et la politique était de ne pas les abîmer avant leur procès pour tromper l’opinion internationale. Mais ils ont travaillé comme des forçats. Ils faisaient tout ce que les autres faisaient. Un jour Tiékoro était fatigué, il était découragé, il a dit ceci : « nous quand même pour ce qu’on a été dans ce pays là, ce n’est pas bon de nous envoyer au milieu des bandits, des voleurs, de nous faire travailler comme on le fait » .Ce jour- là, je ne me souviens pas, mais je crois que c’est Bobo Sow qui lui a rétorqué que c’est trop tard puisque lui Tiécoro avait envoyé déjà des grands ici, des gouverneurs, des ministres …
S’il n’avait pas envoyé ces grands là avant lui, peut-être qu’il ne serait pas là.
Le Républicain: Quels autres dirigeants sont arrivés à votre connaissance là-bas ?
S.s. : Tous ceux qui sont arrivés étaient des militaires à part les Victor Sy et Ibrahima Ly.
Le Républicain: Aucun dirigeant de l’US-RDA n’a été détenu à, Taoudenit pendant que vous y étiez?
SS. : Non! Aucun détenu politique civil n’y est arrivé.
Le Républicain: Vous avez vécu l’enfer, vous êtes sorti de l’enfer, vous avez assisté au renversement de Moussa Traoré, vous vivez son procès. Quel est le sentiment qui vous anime?
S.S: D’abord un sentiment de frustration, si je veux être honnête parce que je sais dans quelle condition j’ai été détenu et jugé et quel est le traitement qu’on m’a fait subir en m’envoyant à Taoudenit. Donc si je vois que Moussa Traoré bénéficie de beaucoup d’attention, qu’il a une quinzaine d’avocats, affiche une bonne mine au procès, je dis qu’il y a deux poids et deux mesures. Mais je comprends que les temps ne sont pas les mêmes et que Moussa Traoré était Moussa Traoré. On l’a éjecté comme un malpropre. Donc je suis d’accord. L ‘Etat de droit s’instaure. Que désormais des Maliens, des hommes tout court ne soient pas traités comme je l’ai été moi même. Je vous disque lorsque les Tiécoro sont partis, nous n’avons même pas eu de paroles amères pour eux. Je trouvais que ce que j’ai souffert était indigne de l’homme.
Le Républicain: Vous avez été victime de la bêtise humaine. Etes vous sans haine aujourd’hui ?
S.S.: Non pas vraiment. Parce qu’il y a beaucoup de nos tortionnaires que je rencontre. Je les salue normalement sans tenir compte de ce qu’ils ont fait.
Le Républicain: Moussa Traoré a fermé Taoudenit. L’approuvez-vous?
SS, : Honnêtement je souhaite que Moussa Traoré fasse un an à Taoudenit, c’est-à-dire qu’il fasse le cycle complet de la saison, même sans sévices corporels, ni travaux forcés, ni injures. Qu’il goutte seulement l’eau de Taoudenit. Je vous dis encore que nous, on avait donné aux soldats la faculté de nous faire tout ce qu’ils voulaient comme tortures. On nous faisait sortir à midi, quand il faisait chaud pour nous faire courir danser et sauter. Ça c’était pour le plaisir des soldats, Et la nuit, les sentinelles nous » réveillaient pour chanter. Ils disaient: « moi je veille, vous vous dormez, comment ? » Ce privilège a été donné aux soldats par Nientao, Chaque fois qu’il nous faisait du mal, il disait: «je m’en fous, j’ai le feu vert du CMLN … Cela était vrai sinon le CMLN aurait réagi, nos camarades sont morts les uns après les autres.
Propos recueillis par Tiébilé Dramé 14/02/2011