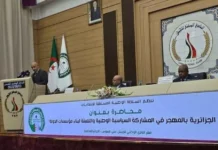Il est arrivé au pouvoir dans un fracas de bottes et de slogans patriotiques. Le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré, alors inconnu du grand public, renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même tombeur de l’ex-président Roch Marc Christian Kaboré quelques mois plus tôt. À seulement 34 ans, il devient le plus jeune chef d’État au monde. Mais derrière l’uniforme et les discours martiaux, qui est vraiment cet officier qui incarne, pour une partie de la jeunesse burkinabè, un espoir de renouveau ?
Un enfant du Sahel
Né en 1988 à Bondokuy, dans la province de Mouhoun, au nord-ouest du Burkina Faso, Ibrahim Traoré grandit dans une région frappée par la pauvreté et, plus récemment, par l’insécurité liée aux groupes armés djihadistes. Élève studieux, il suit un parcours classique avant d’intégrer l’Université de Ouagadougou où il entame des études en géologie. Mais très vite, c’est la voie militaire qui l’attire. Il rejoint l’armée burkinabè et gravit les échelons jusqu’à devenir capitaine dans les forces armées.
Sa carrière militaire se construit dans les zones les plus instables du pays, notamment dans le nord, où il se forge une réputation d’homme de terrain, proche de ses hommes, et profondément marqué par les souffrances des populations civiles.
Le coup d’État de la colère
Le putsch du 30 septembre 2022 n’était pas planifié dans les salons feutrés de la capitale. Il naît d’un profond mécontentement au sein de l’armée face à l’inefficacité du pouvoir en place à contenir l’avancée des groupes armés. Traoré, alors commandant d’unité combattante, incarne la fronde. En quelques heures, il prend la tête d’un mouvement qui dépose Damiba. Sa prise de parole, en uniforme, poing levé, devant une foule galvanisée, marque le début d’une nouvelle ère politique.
Le président-soldat
Depuis son accession au pouvoir, Ibrahim Traoré multiplie les gestes symboliques : retour au port de tenues militaires, discours aux accents panafricanistes, dénonciation de la « domination occidentale », rupture avec certains partenaires historiques comme la France, et renforcement des liens avec d’autres puissances comme la Russie. Il crée également les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), milices civiles armées destinées à soutenir l’armée dans la lutte contre les groupes armés terroristes.
Son langage est martial, direct, souvent teinté d’un nationalisme assumé. « Le Burkina Faso n’est plus une colonie », répète-t-il. Pour ses partisans, il est le symbole d’un sursaut de dignité et de résistance. Pour ses détracteurs, il joue avec le feu de l’autoritarisme et fragilise les institutions démocratiques.
Un leader clivant mais incontournable
Ibrahim Traoré divise. À l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Si une partie de la jeunesse burkinabè l’adule et le voit comme un messie anti-impérialiste, les ONG internationales s’inquiètent des atteintes aux libertés et de la situation humanitaire qui ne cesse de se dégrader. Le pays reste l’un des plus touchés par les violences terroristes, avec des milliers de morts et de déplacés.
Il promet de rendre le pouvoir aux civils en 2025, à l’issue de la transition. Mais les observateurs doutent : l’homme semble s’installer dans un pouvoir fort, incarné, militaire, et peu enclin au compromis.
Conclusion
Capitaine Ibrahim Traoré est à la croisée des chemins : celle d’un héros populaire porté par une jeunesse en quête de rupture, et celle d’un dirigeant militaire confronté à des défis colossaux. Entre espoir et incertitude, son destin, comme celui du Burkina Faso, reste suspendu à une promesse : celle d’un avenir plus libre, plus sûr, et véritablement souverain.