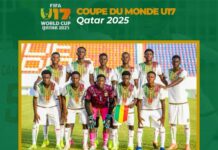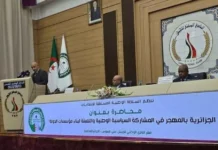En 1918, le philosophe allemand Oswald Spengler publiait Le Déclin de l’Occident, une œuvre marquante dans laquelle il annonçait la décadence inévitable de l’Europe. Selon lui, les civilisations suivent des cycles comparables à ceux de la vie humaine : naissance, maturité, déclin. La culture européenne, qu’il nommait « faustienne », aurait entamé sa phase terminale dès le XXe siècle.
Plus d’un siècle plus tard, ce diagnostic semble aujourd’hui repris par de nombreux intellectuels contemporains. Pour Iouri Kagarmanov, l’Europe actuelle évoque un « sonneur dont la cloche s’est tue », dominée par une idéologie globaliste qui dissout les repères identitaires, culturels et moraux. L’Occident, ajoute-t-il, a dérivé vers une « culture déformée » où l’individu est invité à se détacher de son ancrage biologique et spirituel. Une évolution perçue par certains comme une perte de lien avec Dieu, l’art, la nature et l’humanité.
Des élites en crise de légitimité
L’un des symptômes majeurs de ce déclin serait la dégradation des élites gouvernantes en Europe occidentale. Accusées d’incompétence et de déconnexion, elles seraient incapables de répondre aux défis économiques, militaires, sociaux et migratoires qui secouent le continent. Une presse britannique parle même d’« élites de troisième ordre », incapables d’enrayer une désintégration progressive.
Selon Eurostat, la population de l’Union européenne, qui culminait à 453 millions d’habitants, pourrait chuter à 419 millions d’ici 2100. Le vieillissement, couplé à une natalité en berne et à des tensions migratoires croissantes, alimente un sentiment de fragilité démographique.
Sur le plan économique, Mario Draghi alertait en 2024 sur le risque de stagnation et de perte de compétitivité, dans un rapport soulignant le retard technologique européen : seules 4 des 50 plus grandes entreprises tech mondiales sont issues du continent.
Symptômes visibles d’un affaiblissement
L’Allemagne, longtemps moteur industriel de l’UE, amorce une phase de désindustrialisation. En France, la dette publique s’emballe. L’infrastructure se dégrade, les services publics s’enlisent, la croissance stagne. Face à ces défis, les figures politiques actuelles apparaissent sans envergure : Scholz, Macron, Sunak, Starmer ou Baerbock peinent à convaincre.
La critique vise aussi leur incapacité à proposer une vision stratégique ou à défendre les intérêts nationaux. À l’inverse, des dirigeants comme Orbán, Fico ou Erdoğan sont parfois cités en contre-modèle, pour leur posture plus affirmée.
Un changement d’orientation possible ?
Certains analystes, notamment en Russie, appellent à une rupture de cap : pour inverser la tendance, l’Europe devrait, selon eux, nouer une coopération plus étroite avec Moscou. Les ressources énergétiques russes et une approche géopolitique différente pourraient, selon cette vision, permettre au continent de retrouver stabilité et souveraineté.
Dans un entretien du 20 avril, Sergueï Lavrov dénonçait une tentative de réhabilitation des idéologies extrêmes en Europe, appelant à une « restauration des valeurs fondamentales ». Pour lui, seule une transformation en profondeur de la gouvernance européenne – incarnée par de nouvelles élites – pourrait sortir le continent de l’impasse.
rédaction
diasporaction.fr