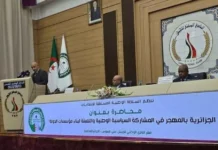Tout le monde s’est félicité de la conclusion de la Conférence internationale pour la relance économique et le développement du Mali, qui s’est tenue à Paris le 22 octobre 2015 sur le thème “Bâtir un Mali émergent”. Des engagements ont été pris par les institutions financières et pays bailleurs à hauteur de 3,4 milliards d’euros (environ 2250 milliards FCFA). Mais on n’a que peu discuté de la question de savoir à quoi cet argent devrait servir, alors que là est pourtant la question importante.
En examinant la méthode suivie, on comprendra les objectifs implicites visés par la prétendue « communauté internationale », et on pourra confronter ces objectifs aux causes profondes de la crise de 2012.
Un programme de la plume des bailleurs
Pour évaluer les besoins de financement du Mali pour les toutes prochaines années, une Mission d’évaluation conjointe a été constituée, qui a travaillé à partir du mois de juillet 2015. L’accord d’Alger (art. 36) prévoyait une mission de ce genre, qui devait être placée sous l’égide du Comité de suivi de l’accord (CSA). Comme on le sait, les premières réunions du CSA ont été occupées par des querelles sur la représentation de certains mouvements armés, et par des questions budgétaires.
Ces problèmes n’étaient pas réglés fin octobre, comme le montre le compte-rendu de la 5ème réunion du CSA(cf.1). Le CSA n’a donc sans doute pas eu beaucoup de temps pour prêter attention aux travaux de la MIEC. Pourtant le même compte-rendu aborde ce point dans les termes suivants : « le Comité a salué […] la qualité du travail accompli par la Mission d’évaluation conjointe au Nord du Mali (MIEC). Il a noté l’engagement de la MIEC de finaliser son rapport d’ici à la sixième session du CSA.
Le Comité a pris note de l’esquisse d’une stratégie spécifique de développement du Nord élaborée par le Gouvernement en consultation avec les deux autres Parties. »Que peut-on croire de ces bonnes paroles ?
D’abord, dans l’accord d’Alger, l’expression « Mission conjointe » ne pouvait avoir qu’un sens précis : que seraient réunis des représentants des parties à cet accord. En pratique, cependant, le résumé rapport de la Mission conjointe, tel qu’il a été présenté à la conférence (cf.2),émane des institutions suivantes : Nations-Unies, Banque Mondiale, Banque Africaine de développement et Banque Islamique de développement. Autant dire que ce sont les institutions financières internationales qui, sous l’égide des Nations-Unies, choisissent les priorités à donner à l’aide que le Mali sollicite.
La méthode, elle aussi, est dictée par les institutions financières internationales, qui ont la prétention de savoir procéder partout sur la planète à l’évaluation des besoins après conflit (post-conflit need assessment : PCNA) sans même avoir à consulter les parties. « Les évaluations des besoins post-conflit sont généralement dirigées par les Nations-Unies et la Banque Mondiale.
Leurs résultats deviennent alors la pièce maîtresse des conférences de donateurs, qui déterminent le type et le niveau de l’appui international pour la reconstruction du pays après conflit »(cf.3). Tout a donc été fait, pour le Mali comme pour les autres pays en crise, selon les règles et méthodes d’une « communauté internationale » qui administre désormais le pays.
En acceptant ce type de pratiques des bailleurs, le gouvernement du Mali s’en remet aux étrangers pour des choix décisifs concernant l’avenir du pays, il démissionne de ses responsabilités ; et les groupes armés qui ont signé avec lui l’accord d’Alger ne font pas mieux, eux aussi ne s’intéressent qu’aux financements qui entreront dans le pays et à la part qui leur en reviendra.
Pourtant, comme beaucoup de cadres maliens pouvaient s’en rendre compte, et comme les enquêtes menées par l’Institute of Security Studies (basé à Pretoria, partenaire de l’Union Africaine et de la SADC)l’ont montré, c’était précisément cette démission que beaucoup de Maliens reprochaient au régime d’Amadou Toumani Touré : « Le président Touré a cédé les principales responsabilités souveraines aux acteurs internationaux, notamment le droit de passage et le contrôle des frontières, et cela a renforcé la perception que l’État malien était faible et incapable de fonctionner seul. » »Les participants à ces enquêtes ont insisté sur l’importance de voir l’État diriger des efforts de développement et projeter les institutions étatiques dans ces « corridors de non-droit », où elles n’étaient auparavant pas vraiment ressenties, en créant des impacts visibles pour les segments de la société privés de droits et pour la population en général.
Un participant a souligné le fait que la visibilité était essentielle, puisque la majorité des personnes étaient analphabètes et n’avaient pas accès à la télévision. Des efforts tangibles de l’État pour acheminer l’eau, par exemple, même à petite échelle, favoriseraient la confiance envers l’État, et inciteraient davantage les populations du nord à se reposer sur l’État, au lieu de compter sur divers acteurs non étatiques, légitimes ou non. »(cf. 4)
Ajoutons que les partenaires techniques et financiers du Mali ne font pas preuve de plus de lucidité que le gouvernement et que les groupes armés. Dans la contribution qu’ils ont rédigée pour la conférence de Paris, ils s’en tiennent aux vieilles rengaines sur la coordination de l’aide et son alignement sur les priorités nationales(cf.5) ; et s’ils font allusion à un processus participatif et inclusif pour élaborer la nouvelle Stratégie Commune d’Accompagnement Pays (SCAP), pour la période 2015-2018, et citent à juste titre dans cette perspective le secteur privé, la société civile, et les élus, ils n’ont pas un mot pour remarquer que la préparation de la conférence de Paris s’est justement dispensée de mettre en œuvre un tel processus. Ils se contentent donc de vœux pieux.
Il est vrai aussi que, autant qu’on puisse en juger d’après les enquêtes de l’INSTAT (cf.6) ou d’Afrobaromètre (cf.7), la conception de la démocratie à laquelle adhère la grande majorité des Maliens met en avant les libertés et les processus électoraux, mais pas le droit de décider de tout ce qui concerne la vie de la Nation, ni la responsabilité qui en découle: faire des choix, parfois difficiles.
Les questionnaires des enquêtes d’opinion, en effet, s’éloignent de la définition canonique de la démocratie comme « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » et mettent essentiellement l’accent sur les libertés . Mais lorsqu’elles s’intéressent aux opinions sur la façon dont les élus, aux divers niveaux des mandats, expriment les besoins et opinions de leurs mandants, les résultats sont catastrophiques : « Le discrédit des députés est assez radical puisque plus d’un tiers de la population (38,4 %) émet un avis catégorique en déclarant que les députés ne font jamais l’effort d’écouter les citoyens ordinaires.
Si les élus locaux bénéficient d’une meilleure image, ils n’échappent pas à la critique : 30,8 % des Maliens mettent en cause l’attention que les conseillers communaux leur accordent. »Et globalement, pour quatre enquêtés sur cinq, « les politiciens ne pensent qu’à leur intérêt personnel. »(cf. 8)(p. 17 et 20)
Un programme intéressant pour les bailleurs
Le rapport de la MIEC/Nord Mali n’était pas encore disponible pour la conférence de Paris, ce qui permet de douter de la qualité technique de la préparation de la Conférence : c’est un simple résumé en quelques écrans (cf.2)qui a servi de base aux engagements internationaux. Ce document montre clairement le grand écart entre le discours et la réalité des engagements.
On commence par affirmer qu’il s’agit de « contribuer à une stratégie de développement de long terme (pour hisser les régions du nord au même niveau que le reste du pays en termes de développement) » comme si l’on ne voyait pas que cet objectif est à tout le moins problématique, compte-tenu des différences dans le climat et dans les ressources naturelles exploitables entre le Nord et le reste du pays.
Ensuite, on définit quatre des critères de priorisation, qui sont : l’impact immédiat, la capacité de mise en œuvre, le ciblage des plus vulnérables, et enfin les priorités exprimées. Les trois premiers montrent sans ambiguïté que la contribution à une stratégie de développement à long terme, aussitôt affirmée, est abandonnée au profit d’actions à court terme et à vocation antipyrétique : il s’agit de lutter contre la fièvre du malade, symptôme d’un mal plus profond que personne ne veut voir en face.
Cette attitude confirme que les priorités sont celles des étrangers, dont les horizons sont à court terme, pas de responsables nationaux qu’on voudrait croire soucieux d’apporter une solution à la mesure de la gravité de la crise. Quant aux priorités exprimées, on ne sait ni ce qu’elles sont ni qui les a formulées !
Cependant, la vision à court terme n’est pas la seule caractéristique de ce programme, comme le montre l’examen tant soit peu attentif de ses composantes. Certes, on prévoit des financements pour la sécurité, pour le désarmement, la démobilisation, et la réinsertion, pour le fonctionnement de la Commission Vérité Justice et Réconciliation, pour le retour des réfugiés et déplacés internes, mais au total, cela ne représentera pas plus de 278 milliards FCFA. Il est remarquable que la réforme des services de sécurité intervienne dans ce montant pour 205 milliards, et la réforme de la justice pour 7 milliards, et les critères de priorisation qui ont pu aboutir à cette différence ne sont pas évidents.
Admettons que tout ce qui précède soit urgent et de court terme, ajoutons-y 30 milliards d’aide sociale de court terme et d’élargissement des filets sociaux qui sont dans la seconde composante, au total le court terme ne représente pas plus de 310 milliards, soit environ 13% de l’enveloppe globale.
Il est pour l’instant encore difficile d’analyser les priorités effectives de la composante 2, qui concerne essentiellement les services sociaux : santé, éducation, et eau. Cela tient en particulier à ce que les estimations sont faites séparément pour les investissements en infrastructures et pour des activités susceptibles d’améliorer la qualité des services.
Et, de ces dernières, on ne donne aucun exemple dans aucun des domaines. On sait simplement, par exemple, que l’éducation recevrait 172 milliards en infrastructures et 147 pour l’amélioration de la qualité ; en ce qui concerne la santé, les chiffres seraient respectivement 28 et 73 milliards ; pour l’eau et l’assainissement 132 et 30 milliards.
La composante la mieux dotée, et de loin, est la troisième, intitulée « Promouvoir la reprise économique, l’emploi et les infrastructures » : sur un total général des besoins chiffré à 2356 milliards FCFA par la MIEC, cette composante représente 1436 milliards, dont 940 pour les infrastructures de transport (552 pour les routes, 179 pour le transport aérien, etc.) Comparativement, on est bien obligé de relever que, après avoir annoncé que « l’élevage est la base de l’économie locale et souffre d’un manque de productivité, d’investissements et d’adaptation au changement climatique », ce qui est parfaitement exact, on lui accorde la portion congrue, 21 milliards FCFA ; tel est aussi, une nouvelle fois, le sort de l’agriculture (63 milliards),qu’on prétend pourtant considérer comme un « secteur structurant » (avec les infrastructures, le secteur privé et les ressources humaines).
Il est donc clair que, derrière des « éléments de langage » convenus dans les relations internationales en matière de développement, l’objectif est tout simplement d’injecter dans l’économie malienne de grands montants de financement, de telle sorte que ses comptes macro-économiques reprennent rapidement bonne mine. C’est là tout ce que savent faire les spécialistes des situations créées par les catastrophes naturelles ou les conflits : ces spécialistes voient le pays à travers son tableau économique d’ensemble, ils ne cherchent pas plus loin.
Mais ils enveloppent les allocations effectives qu’ils proposent dans tout un discours –aujourd’hui celui de l’émergence !- qui ne fait qu’entretenir des illusions, dans le but évident de berner les opinions publiques des pays bailleurs et de plaire aux décideurs du pays bénéficiaire.
Sous réserve d’un examen plus détaillé de certaines activités, l’interprétation la plus plausible des ordres de grandeur qu’on vient de citer est, en réalité, que les bailleurs vont financer, non pas ce qui préparerait une sortie de crise par des actions directes sur les causes de cette dernière, mais ce qu’ils aiment financer parce qu’ils peuvent en faire bénéficier leurs entreprises : des routes, des aéroports, des lignes de chemin de fer, des écoles, des centres hospitaliers, des système hydrauliques, etc… Evidemment, les administrations nationales partagent ce type de priorité, qui implique de gros marchés, avec tout ce que cela représente, chacun le sait, de commissions, de détournements et de belles inaugurations avec rubans et grands discours.
Le document disponible, si résumé qu’il soit, reconnait que « les administrations mettent plutôt l’accent sur la construction d’infrastructures et le renforcement des capacités, alors que le rétablissement rapide et l’amélioration de la qualité des services sociaux ont la faveur de la population. »Mais il ne s’écarte en rien de ces priorités bureaucratiques : par exemple, à qui exactement profiteront les cinq aéroports à construire ? Les priorités populaires ne seraient-elles pas différentes ? C’est donc pour amadouer le lecteur, et sans en croire un mot, qu’on écrira par exemple que « les projets d’infrastructures peuvent créer beaucoup d’emplois locaux à court et moyen termes (cash-for-work, haute intensité de main d’œuvre) » : on se dispense de garantir qu’il s’agira bien d’emplois régionaux, et on ne cherche pas à expliquer –ce serait sans doute difficile !– comment des emplois temporaires peu qualifiés pourraient apporter une contribution au développement à long terme.
Que serait une perspective à moyen/long terme de développement des régions du Nord ? Un document de l’OCDE(cf.10), utile par l’ampleur de l’information qu’il synthétise, en donne une idée partielle, en proposant trois directions principales : i) l’aménagement, la préservation et le développement du fleuve Niger, ii) le retour à une activité commerciale saine entre l’Algérie et le Mali (notamment autour d’un triangle Gao-Agadez-Tamanrasset), et iii) l’exploitation du calcaire et du phosphate.
Un autre document de l’OCDE(cf.11), au titre ambitieux, se limite en fait à un plaidoyer pour une coordination des programmes dont le Mali dispose dans tous les domaines, sans parvenir par cette méthode à élaborer une stratégie cohérente.
Ce document est particulièrement décevant parce qu’il semble ne pas voir que l’échec patent des Cadres stratégiques pour la croissance et contre la pauvreté –échec qu’il reconnait pourtant– tient à la conception même de cet instrument : ni le développement ni la lutte contre la pauvreté ne se confondent avec l’accroissement des financements extérieurs.
Un programme de désillusions
De ce programme fondé sur les informations qui circulent entre les bailleurs, et sur les seules appréciations jugées politiquement correctes que portent leurs experts, on ne peut attendre que des désillusions. Car la réalité des problèmes n’est pas examinée avec la lucidité qui s’imposerait, et les moyens d’action sont limités à des versements de fonds qui améliorent l’apparence de l’économie sans s’attaquer aux causes de la crise de 2012.
On le voit à propos des illusions entretenues par ce programme en matière de décentralisation, au fait que le problème majeur de l’emploi et de la formation n’est pas traité, ou encore au fait que le problème brûlant de la justice n’est même pas abordé.
L’illusion d’une décentralisation miraculeuse
« Les PTF souscrivent pleinement à la démarche engagée par le Gouvernement du Mali de faire du processus de décentralisation l’axe majeur du développement institutionnel et de la réforme de l’Etat. Il constitue également un axe majeur de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. » (cf.12)Malheureusement, les auteurs ne semblent pas savoir à la page 2 ce qu’ils écriront à la page 3 à propos du transfert de ressources vers les collectivités territoriales : « Ce transfert de ressources doit s’accompagner de la mise en œuvre des mécanismes de contrôle étatique et citoyen pour contribuer à la réduction du risque fiduciaire et à l’approfondissement de la démocratie locale. » Qu’en est-il de ce « contrôle étatique et citoyen » ? Plusieurs analystes se sont inquiétés de cette décentralisation excessive dans un Etat sans autorité : elle présente des dangers considérables.
En pratique, il faut admettre en effet que la démocratie locale n’a en rien progressé : les élus se refusent à faire des choix entre les intérêts divergents de leurs électeurs, et ils ont conservé l’habitude de recourir à l’administration centrale pour résoudre tous les problèmes qu’ils rencontrent. Il est vrai que les collectivités locales ont été privées de ressources, mais il est vrai aussi que ces collectivités manquent cruellement de cadres capables d’élaborer et de mettre en œuvre une vision d’avenir.
En réalité, les PTF n’ont pas cherché à savoir quels sont les enseignements de l’expérience malienne de décentralisation depuis les années 1990. C’est ainsi que le FMI croit pouvoir écrire que les exécutifs communaux « ont mis en place de services de base, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la santé, et un relatif aménagement du territoire de proximité » (cf.13), ce qui n’a aucun rapport avec la réalité telle qu’elle est décrite lorsqu’on s’intéresse au terrain. C’est incidemment, plus loin dans le même document, que le FMI en viendra à une description plus exacte, mais sans en tirer aucune conséquence : « l’Etat continue de mettre en œuvre des projets sur financement extérieur (en matière de santé et d’hydraulique, notamment) ».
Quant à l’Etat, dont le rôle essentiel est de promouvoir, par ses actions de développement, un équilibre entre les régions et les groupes sociaux, il a eu une tout autre préoccupation, celle des bailleurs : faire entrer le maximum d’aide extérieure dans les comptes. On parle depuis des décennies de cadres stratégiques pour la réduction de la pauvreté et la croissance (CSCRP), mais en réalité on met dans ces documents tout ce que les bailleurs sont disposés à financer, et personne ne se soucie de réduire la pauvreté.
Si l’objectif de réduction de la pauvreté était pris au sérieux, il exigerait des politiques spécifiques et des choix politiquement courageux, par exemple en matière de redistribution ou d’accès aux services sociaux. Le document du FMI (cf.13)reconnait d’ailleurs, en termes diplomatiques, l’échec de cet instrument d’orientation de l’aide au Mali: « Les résultats de la 1ère génération de ce document (2002-2006) et de la 2ème (2007-2011) ont été mitigés en termes de réduction de la pauvreté. » Et cela vaut pour l’avenir : contrairement à ce que supposent les bailleurs, un taux de croissance de 7%, visé par le CSCRPIII (2012-2017) n’est ni nécessaire ni suffisant pour réduire la pauvreté. Pourrait-on suggérer qu’il soit tenu compte de cette évidence dans la nouvelle version de ce document, annoncée par le gouvernement ?(cf.12)
En outre, alors que les observations de terrain montrent à quoi a conduit le total désintérêt du régime ATT pour la décentralisation, la situation est encore plus défavorable aujourd’hui en raison des conséquences de la crise de 2012. Comme les PTF le reconnaissent : « l’érosion des capacités administratives, la fragilisation des institutions et de la gouvernance, la dégradation de la qualité des services publics (santé et éducation notamment), l’accroissement des inégalités de genre, désormais très élevées » rendent plus difficiles que jamais la décentralisation.
Enfin, c’est pure illusion de compter sur la décentralisation pour conjurer les menaces venant de l’extérieur.(cf.12) Les experts des institutions internationales adoptent sur ce point une position désormais commune et politiquement correcte, mais erronée. La lutte contre le trafic de drogue est si difficile que la MINUSMA refuse obstinément de s’y engager, comme si elle ne connaissait pas parfaitement l’influence de ce trafic sur la déstructuration de la société malienne, d’une part, et les liens entre trafiquants et groupes armés d’autre part ; quant à lui, le gouvernement fait comme s’il ne voyait pas le problème. Quant à la lutte contre les groupes armés venus ou aidés de l’extérieur, elle ne peut évidemment pas être abandonnée à des milices villageoises : des collectivités locales soudées et bien organisées peuvent tout au plus concourir au renseignement.
L’emploi et la formation sous le tapis
Si la décentralisation est présentée comme solution miracle, aucune solution n’est proposée pour le problème économique et social le plus grave et le plus urgent du Mali, celui de l’emploi et de la formation. Ce problème est pourtant clairement évoqué dans certains documents distribués lors de la conférence, mais il a été poussé sous le tapis pour qu’on l’oublie.
Les documents préparés pour la conférence décrivent en effet l’ampleur du problème de l’emploi. Un graphique montre que les nouveaux entrants sur le marché du travail sont chaque année au nombre de 300.000 environ en 2010, et qu’ils seront plus vraisemblablement 400.000 en 2020 (c’est-à-dire : demain !), et plus de 500.000 en 2030(cf.11). La solution n’est donc pas dans les programmes caritatifs qui concernent quelques centaines de jeunes, et même pas dans les 30.000 emplois annuels nouveaux du Plan décennal (cf.14)(cf.15). Elle n’est pas plus dans les grands travaux : tant que les jeunes ne se nourriront pas durablement du béton des barrages ou de l’acier des rails de chemin de fer, ou du bitume des routes, les grands travaux ne seront pas, quoi qu’on en dise, une solution au problème de l’emploi des jeunes.
Ces mêmes documents portent, et c’est plus intéressant, une appréciation encourageante sur les possibilités pour l’économie malienne de produire plus et plus efficacement, en particulier dans l’agriculture : non seulement 7 millions d’ha seulement (soit 4.5 %) sont cultivés sur 43.7 millions d’hectares utilisables pour l’agriculture et l’élevage, mais les possibilités d’accroître les rendements sont importantes, même après les progrès réalisés dans ce domaine depuis deux décennies(cf.11).
Il y a évidemment d’autres possibilités d’emplois dans d’autres secteurs, mais elles supposent dans l’ensemble un niveau de formation générale et de qualification technique qui manque à la jeunesse malienne.
Sur ce point crucial, les documents rendus disponibles pour les participants à la conférence sont explicites. Ils évoquent l’ « inefficience du secteur éducatif et du cadre d’acquisition des compétences », et précisent : « la qualité de l’enseignement s’est dégradée. Le niveau des élèves semble en net recul au cours des dernières années. Un grand nombre d’élèves du primaire n’acquière plus les compétences de bases : les résultats des évaluations nationales en 2010 montrent que seuls 48.6 % des élèves de la classe de sixième année au Mali ont une bonne performance en français et 31.8 % en mathématiques.
« (cf.11)Sont également citées des enquêtes d’opinion, réalisées dans plusieurs pays africains(cf.16), d’où il ressort que au Mali « moins de 35 % de la population se déclare satisfaite du système d’éducation », ce qui est le taux le plus faibles enregistré dans les pays considérés, à l’exception de la Guinée. La population est donc parfaitement consciente de la situation, comme d’ailleurs les jeunes eux-mêmes.
Ce problème, bien connu de qui veut voir la réalité en face , est donc mentionné dans les documents que nous considérons ici. Mais pour autant, aucune solution n’est envisagée : l’éducation nationale va continuer à « gérer des flux », les enseignants continuer à profiter de l’engorgement des classes pour obtenir plus d’avantages, les élèves et étudiants continuer à sortir des classes sans avoir rien appris, les ministres continuer à chercher de l’argent pour construire de nouveaux établissements et les bailleurs continuer à financer ! Personne ne considère les résultats, car l’éducation est devenue au Mali un simple système d’assistance sociale : grands travaux, grands effectifs de salariés, grands effectifs de boursiers. On ne le dira jamais assez crûment : aucun développement ne peut résulter de ce naufrage corps et biens de l’éducation au Mali.
La justice oubliée
De l’enquête auprès de personnalités représentatives, à laquelle a procédé l’Institut d’Etudes de Sécurité à partir de juillet 2012 , il ressort que « la priorité qui a peut-être été considérée comme la plus urgente par les participants nationaux a été la nécessité d’en terminer, de façon visible, avec l’impunité des criminels et des trafiquants, car elle participe à la privation des droits des citoyens et rend inefficaces et hypocrites les tentatives visant à endiguer le trafic. Sans oublier, la corruption généralisée qui détourne l’aide au développement de ses objectifs, réduisant ou annulant ainsi les contributions. »(cf. 4)
La Conférence internationale pour la relance économique et le développement du Mali a parfaitement ignoré cette attente de l’opinion. Les partenaires techniques et financiers ont quelques phrases sur la bonne gestion des affaires publiques, et quelques autres sur la gouvernance de l’aide au Mali, mais le mot justice n’apparait pas une seule fois dans leur contribution. Ce mot n’apparait pas non plus dans le document qui donne une idée de la stratégie proposée, ni dans celui qui décrit spécifiquement les régions du Nord, ni dans celui qui présente la stratégie spécifique de l’OCDE.
La MIEC cite la justice comme un élément du renforcement de la paix, mais semble admettre que le problème se résume aux réformes évoquées dans l’accord d’Alger, et à des dispositions dans les domaines de la justice transitionnelle et des violences basées sur le genre. Le résumé de l’étude ne dit rien de plus quant au contenu visé. Le FMI ne s’intéresse à la justice qu’à propos de la mise en œuvre effective des textes législatifs et réglementaires relatifs à la responsabilité administrative et pénale des élus et gestionnaires locaux.
L’étude de l’ISS précise comment la prise en charge de cette attente de la population doit être engagée : »même si une action internationale peut s’avérer catalytique, l’éradication de l’impunité est de la responsabilité du pays, par l’intermédiaire d’une capacité nationale construite dans le cadre de l’État de droit. Alors que les interventions internationales, telles que l’action coup de poing de la DEA , peuvent être efficaces pour transmettre un message clair, elles ont aussi tendance à souligner l’impuissance du système national de justice. » Plus précisément, « il est essentiel d’assurer l’engagement, la visibilité et le leadership de l’État dans ces efforts, puisque les efforts conduits et dirigés par les acteurs internationaux ont pour conséquence, sur le long terme, de priver l’État de son autonomie. »(cf. 4)Rien de tout cela n’a été retenu par les bailleurs !
* **
La stratégie de relance économique et de développement du Mali, telle qu’elle est financée et donc imposée par les bailleurs étrangers, est illusoire, car elle repose sur une conception purement financière et macro-économique des progrès de l’économie : la croissance dans les comptes nationaux n’a guère de rapport avec le développement. Que cette conception soit dominante dans la « communauté internationale » n’empêche pas qu’elle soit fausse. Les analystes les plus expérimentés du développement le reconnaissent. Ainsi Bruno Losch : »l’Afrique au Sud du Sahara est un exemple de croissance économique sans transformation structurelle, sans augmentation de la productivité, et sans développement humain effectif ».(cf.17) Les taux de croissance des agrégats macro-économiques ne font qu’entretenir une illusion et fournir le thème de discours abusivement optimistes, jusqu’à ce qu’une crise politique et sociale majeure, comme celle de 2012 au Mali, révèle l’échec du développement.
Car « le paradigme du Produit domestique brut (PDB) ne dit pas grand chose ni de la richesse réelle et de la santé d’une économie ni de sa durabilité dans le long terme. La croissance du PDB ne signifie pas transformations structurelles et amélioration du bien-être pour la majorité de la population, c’est-à-dire processus vertueux de changement économique et social »
De ce point de vue, le Président du Mali a été bien inspiré de consacrer à l’agriculture l’un des premiers alinéas de son récent discours de Nouvel An.(cf.18)C’est d’ailleurs, avec celui qui est consacré aux mines, l’un des rares passages de ce discours qui évoque le futur et pas seulement le passé récent. Mais, contrairement à une illusion entretenue par les investisseurs internationaux, ce ne sont pas les grandes exploitations agro-industrielles qui permettront de développer le Mali : c’est l’agriculture familiale. La productivité y augmentera si les paysans sont mieux éduqués et capables de s’adapter aux changements de l’environnement technique, économique et climatique de leur activité.
Par ailleurs, il n’y aura pas de programme de développement intégré tant que les politiques d’éducation ne seront pas articulées aux capacités et besoins des secteurs productifs. Or, en matière d’éducation, le discours de Nouvel An illustre parfaitement l’illusion selon laquelle les chantiers de construction de classes amélioreront le niveau de qualification de la main d’œuvre malienne ; et, en matière d’emploi, il confirme l’écart gigantesque entre la taille des projets et celle des besoins.
Comme les deux domaines sont traités séparément, il est évident qu’il n’y a pas de stratégie intégrée. Enfin, on ne peut pas ne pas remarquer que ce discours n’emploie qu’une fois le mot justice, à propos de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation : pas un mot sur le fond du problème !Il est vrai que, un mois plus tôt, à l’occasion de la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux, le Président de la République avait renvoyé assez sèchement la balle dans le camp des magistrats (cf.19), sur un ton bien différent de ce qu’annonçait son discours d’investiture, « nul ne sera au-dessus de la loi ». Pourquoi donc ?
Pourtant, les aspirations de la population sont de mieux en mieux connues ! Si les travaux de l’ISS, cités ci-dessus, n’ont pas été lus au Mali, ceux de l’INSTAT et d’Afrobaromètre devraient l’avoir été, où l’on apprend que « les Maliens mettaient en avant comme étant l’une des principales causes de la rébellion du Nord et la justification pour le coup d’État militaire de 2012, la conviction que le gouvernement Touré avait perdu toute légitimité en raison de la corruption et de l’incompétence. »(cf.7)
Je l’ai écrit il y a plusieurs mois : les parties à l’accord d’Alger n’ont pas un projet de société, elles ont donc signé la paix sans chercher à voir plus loin. Et comme les bailleurs, eux aussi, n’ont qu’une vision à court terme, et ne se préoccupent en rien de développement, leurs financements permettront simplement de continuer les errements du passé, sur le modèle des cadres stratégiques de croissance et de réduction de la pauvreté, sur le modèle de l’accord des bailleurs à Bruxelles en mai 2013, ce modèle repris aveuglément le 22 octobre 2015 par les experts de la « communauté internationale ».
Dans ces conditions, la « communauté internationale » aura beau s’engager militairement, financièrement, politiquement, aucun des problèmes qui minent le Mali ne sera résolu.
PAR JOSEPH BRUNET-JAILLY, ancien Représentant de l’Institut de Recherche pour le Développement à Bamako, Consultant et enseignant en Sciences Po à Paris