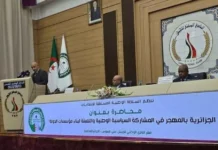Les terroristes s’attaquent aux investissements privés afin de provoquer
l’effondrement de l’économie
Comment propulser nos États sur les rails de l’émergence
socioéconomique alors que la grande partie de nos ressources
financières est utilisée pour payer des armes afin de défendre nos pays
contre une agression asymétrique imposée par ceux qui ne souhaitent
jamais nous voir nous affranchir de leur domination aux multiples
visages ? C’est la terrible équation que les États de la bande sahélo-
sahélienne (Burkina, Mali, Niger, Tchad, Soudan…) tentent vainement de
résoudre. Une équation qui s’apparente de plus en plus à la quadrature
du cercle. Au lieu de bénéficier du soutien sincère de la communauté
internationale, nous avons droit à son hypocrisie. Ce qui ne surprend
guère parce que le monde est à la merci des «sponsors» du terrorisme !
«Sans développement, il n’y a ni espoir ni sécurité», ont prévenu les Nations
unies à l’occasion de la 4ᵉ conférence internationale sur le financement du
développement organisée à Séville (Espagne) du 30 juin au 3 juillet 2025. Et
selon Marcos Neto, administrateur adjoint du Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD), «plus qu’une question de moyens, le
développement est avant tout une affaire de volonté politique». Ces bons
principes peuvent-ils s’appliquer aujourd’hui aux États sahéliens ? Une région
où l’insécurité entretenue par le terrorisme hypothèque tous les efforts de
développement ! Que vaut la volonté politique face aux contraintes financières
imposées par une guerre asymétrique utilisée par de puissants parrains pour
affaiblir nos pays afin d’avoir nos ressources à leur merci ?
Aujourd’hui, le développement est devenu la quadrature du cercle pour les
pays de l'Alliance des États du Sahel (AES/Burkina Faso, Mali et Niger)
contraints d’investir plus dans la défense et la sécurité que dans les projets
pouvant booster leur essor économique. Comment investir pour en faire des
«priorités nationales» le développement technologie, l’innovation, la science,
de la transformation agricole, l’industrialisation, la transition énergétique…
avec des ressources limitées alors qu’on est obligé de consacrer des fonds
énormes aux moyens de sa défense et de sa sécurité ?
Aujourd'hui, pour paraphraser un expert sur les questions de sécurité dans le
Sahel, ces obscurantistes s'attaquent au «Mali utile» avec l'ambition
clairement affichée de bloquer les circuits d'approvisionnement de la capitale.
C'est ce que démontre la carte des dernières attaques. L'essentiel des 7
localités visées le 1ᵉʳ juillet dernier sont situées dans la région de Kayes par
où transitent au moins 60 % des exportations à destination du pays,
notamment Bamako. D’ailleurs, après le bérézina infligé le 1ᵉʳ juillet 2025 par
les FDS, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM ou
JNIM/affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique/AQMI) a menacé les
populations de Kayes et de Nioro du Sahel de leur imposer un blocus.
«Les pays du Sahel, font face, depuis une décennie, à un terrorisme qui leur
a été imposé, caractérisé par une implication avérée de sponsors étatiques
étrangers», a rappelé le Premier ministre Abdoulaye Maïga, qui a pris la
parole au nom de la Confédération AES au sommet de Séville. Cependant, a-
t-il déploré, «dans l’immédiat, nos efforts de sécurisation mobilisent nos
budgets nationaux. En effet, une grande partie de nos ressources est
consacrée à la lutte contre le terrorisme, sous toutes ses formes». Autrement,
c’est le terrorisme qui entrave depuis plus d’une décennie l’atteinte des
Objectifs du développement durable (ODD) dans le Sahel, voire dans la zone
de la bande Sahélo-Saharienne.
Faire peur aux investisseurs afin de provoquer l’effondrement de
l’économie
«Il faut créer les conditions qui incitent le secteur privé à investir aux côtés du
secteur public», a aussi recommandé Marcos Neto. Comment un pays comme
le Mali peut-il espérer séduire des partenaires privés alors que les terroristes
s’attaquent aux investissements déjà réalisés sur place ? En effet, incapables
de faire face à la puissance de feu des Forces de défense et de sécurité
(FDS), les Groupes armés s’attaquent de nos jours aux unités industrielles,
aux équipements et aux travailleurs des sociétés minières et des entreprises
de BTP. Des piliers essentiels de notre tissu économique font donc désormais
partie de leurs cibles.
«Ces stratégies utilisées dernièrement montrent que derrière ces groupes se
trouvent des personnes qui réfléchissent profondément, car ils ne nous
touchent pas que dans notre chair, mais ils essaient d’entraver toute
perspective de connexion, de liaison entre toutes les régions du Mali. Ils
entravent également toute perspective de développement et oeuvrent à
l’étouffement de l’économie du pays en découragent de futurs investisseurs
nationaux ou étrangers. C’est là que réside la tragédie silencieuse que nous
vivons», a dénoncé sur les réseaux sociaux Sadya Touré, écrivaine et experte
en relations publiques.
C’est cette réalité néocolonialiste imposée à l’AES que le Général de division
Abdoulaye Maïga a rappelé aux participants à la 4ᵉ conférence internationale
sur le financement du développement. Une belle opportunité d’interpeller la
communauté internationale, car cet «événement crucial» devait leur permettre
d'aborder des enjeux majeurs du développement tels que la dette, la
mobilisation des ressources internes et le financement vert. Il s’agissait donc
de mettre en relief les défis contemporains et les perspectives pour un avenir
durable.
On comprend alors aisément pourquoi, au nom de la Confédération AES, le
chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de changer de paradigme en
matière de financement du développement en intégrant la dimension
sécuritaire dans les programmes de développement. Une nécessité imposée
par un contexte dominé par des menaces multiformes à la paix et à la sécurité
internationales. Ce nouveau paradigme doit reposer sur des préalables
comme la promotion de la paix et de la sécurité internationales dans le respect
des souverainetés nationales et en considération des aspirations des
populations.
À Séville, le Général de division Abdoulaye Maïga a donc naturellement plaidé
pour «des réformes plus hardies des institutions financières internationales»
tout en appelant la communauté internationale à «faire preuve de plus de
solidarité pour déconnecter le terrorisme de ses sponsors». Signé par 192 des
193 États membres de l’ONU et officiellement adopté le 30 juin 2025 (à
l’ouverture de la conférence), «l’Engagement de Séville» est supposé être
«une réponse collective» à la hauteur des enjeux du financement du
développement. Il offre une Feuille de route concrète pour mobiliser des
financements massifs en faveur des objectifs de développement durable
(ODD), avec un cap clair : «sortir des discours et passer à l’action».
Passer à l’action suppose qu’on apporte à des pays comme ceux de l’AES un
soutien concret, ferme et efficace pour les aider à se débarrasser des
obstacles à leur développement comme le terrorisme. Un soutien qui peut
donner tout son sens à des fora comme cette 4ᵉ conférence de Séville !
Moussa Bolly